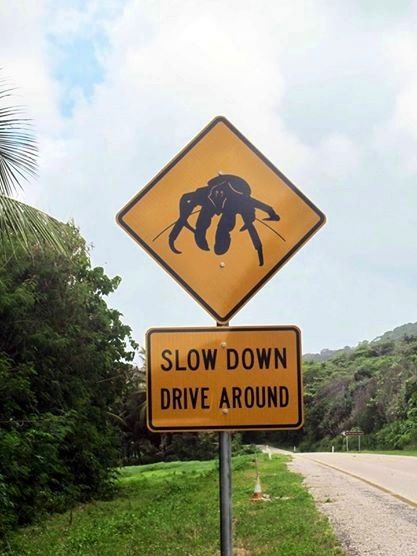![]()
Si vous avez apprécié cette manière originale de visiter un pays,
avec le précédent épisode (voir →
ICI), alors nous restons en Afrique, pour poursuivre le voyage dans ce qui est certainement le pays le plus prolifique sur le thème de l'héraldique sur timbres:
le Gabon
Deuxième partie : années 1975/1979Nous avons déjà parcouru dans le premier volet 14 villes parmi les plus importantes du pays et une première région ou province, par le biais de leurs armoiries, ainsi que les emblèmes d'état que nous allons encore retrouver plusieurs fois et sous d'autres formes.
Ce voyage virtuel nous a permis de faire le point sur les principales ressources, la nature, les traditions, l'histoire de ce petit pays d'Afrique, sans occulter son long passé colonial. Cette approche confirme et justifie encore le sous-titre de mon blog : l'héraldique est une passerelle spatiotemporelle, etc...
![]()
Nous allons poursuivre ce voyage dan un ordre chronologique à travers les timbres émis sur le sujet des armoiries, avec 3 nouvelles provinces et de 12 nouvelles villes ou districts.
La structure territoriale, le découpage administratif du Gabon sont assez compliqués. Le pays est en effet composé de :
- 9 provinces - 50 départements - 152 cantons - 50 communes - 26 arrondissements - 26 districts - 3 483 villages et groupes de villages.
source infos : www. stat-gabon.org Les seules entités qui ont hérité d'armoiries sont : les provinces, certaines communes et certains districts. Cela explique que quelques noms déjà cités dans le premier volet vont être à nouveau évoqués cette fois et la suivante : comme par exemple
Oyem, mentionnée avec la commune la dernière fois et remise en scène avec le district, cette fois. Mais allons voir cela sans plus attendre...
.
Villes et région du Gabon - série V
année 1975
N° 338 YT
(ordre et numérotation du catalogue Yvert & Tellier)N° 551 MI
(ordre et numérotation du catalogue allemand Michel) Armoiries de la province d'
Ogooué-Ivindo- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"De gueules semé d'abeilles d'or, au pairle d’argent brochant sur le tout". Timbre: couronne d'or antique à pointes de lance des provinces gabonaises.
• Le champ "semé d'abeilles" symbolise la "
Forêt des abeilles" sur la rive gauche du fleuve
Ogooué, au sud de Booué, une zone de biodiversité exceptionnelle.
• Le pairle identifie la confluence de l'
Ogooué et de son affluent : l'
Ivindo.
cliquer sur le lien ci-dessous pour lire la suite :
année 1975
N° 339 YT
N° 552 MI
Armoiries de
Moabi (
ville de la province de Nyanga)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"De sable au palmier fruité d'or, mouvant de la pointe, mantelé dentelé du même à deux papegais affrontés de sinople, becqués et membrés de gueules".
• Les palmiers à huile sont la richesse naturelle du district.
• Le trait en dent scie rappelle l'exploitation forestière.
• Les perroquets (papegais en ancien français) comptent quelques espèces vivant au Gabon. Le plus connu est le "gris du Gabon" (
Psittacus erithacus), un beau parleur. Celui du blason : avec plumage vert, pattes et bec rouges ne semble pas être identifiable à une espèce vivant en Afrique.
année 1975
N° 340 YT
N° 553 MI
Armoiries de
Moanda (
ville de la province de Haut-Ogooué)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"D'argent à l'aigle de sable, lampassée de gueules, posée sur un tourteau au sommet fendu en pointe du même".
• Le tourteau de gueules éclaté rappelle l'exploitation de mines d'uranium entre
Moanda et
Franceville, et symbolise la fission d'un noyau atomique . L'aigle figure l'énergie considérable qui en ressort.
Villes et région du Gabon - série VI
année 1976
N° 365 YT
N° 606 MI
Armoiries de la province de
Nyanga- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"D'azur à la cotice d'argent dentelée sur le haut, accompagnée de deux poissons tarpons du même, celui de la pointe contourné; chef ondé d'or, chargé d'un lion passant de gueules, armé et lampassé d'azur". Timbre: couronne d'or antique à pointes de lance des provinces gabonaises.
• Le bleu/azur du champ et les poissons tarpons (
Megalops atlanticus) représentent la façade maritime de la province, et le trait de partition ondé symbolise le fleuve
Nyanga.
• La cotice dentelée, comme une lame de scie, rappelle encore ici l'exploitation forestière.
• Le chef d'or rappelle la savane, le lion au sommet signifie : "je monte la garde à la frontière".
année 1976
N° 366 YT
N° 607 MI
Armoiries de
Mandji (
ville et district de la province de Ngounié)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"De gueules aux trois lances d'or posées en faisceau, chapé de sinople, au chevron d'or dentelé sur le haut, brochant sur le chapé".
• L'or et le sinople évoquent la richesse des forêts du district. Et nous avons encore ici le dentelé de la scie pour rappeler l'exploitation du bois.
• Le chevron symbolise les deux rivières
Doubandji et
Ovighi autour desquelles vivent trois tribus de l'ethnie
Eschira représentées par les sagaies (lances).
année 1976
N° 367 YT
N° 608 MI
Armoiries de
Mékambo (
ville et district de la province d' Ogooué-Ivindo)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"D'or à deux marteaux de sable posés en sautoir, accompagnés de quatre flammes de gueules ".
• Les flammes et les marteaux représentent les forges de
Mékambo.
Villes du Gabon - série VII
année 1977
N° 377 YT
N° 625 MI
Armoiries de
Omboué (
ville et district de la province d' Ogooué-Maritime)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"D'or au crocodile de sinople denté de gueules, au franc-quartier de sinople ".
• Le crocodile évoque les lagunes dont celle de
Fernan-Vaz près d'
Omboué, qui tient son nom de celui d'un navigateur portugais qui la découvrit au XV
e siècle.
• Le franc-quartier symbolise la réserve de faune et les forêts du
Parc National de Loango.
année 1977
N° 378 YT
N° 626 MI
Armoiries de
Minvoul (
ville et district de la province de Woleu-Ntem)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"De sinople au poisson-chat d'argent chapé de gueules, au chevron d'argent brochant sur le chapé".
• Les couleurs rouge et blanc évoquent la culture du café et le vert la forêt.
• Le poisson-chat africain ou silure (
Clarias gariepinus) représente une des principales ressources de la pêche dans la région.
• Le chevron symbolise les deux routes menant à
Minvoul.
année 1977
N° 380 YT
N° 627 MI
Armoiries de
Mayumba (
ville et district de la province de Nyanga)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"De gueules à la croix de Malte d'argent, flanquée à senestre d'un dauphin ployé d'or, allumé de sable".
• Le dauphin rappelle que la commune est située sur la côte de l'Océan Atlantique.
• Le champ de gueules et la croix évoquent le blason de l'
Ordre souverain de Malte qui a établi dans ce lieu une léproserie.
Emblème d'État
année 1977
N° 388 YT
N° 636 MI
Armoiries de la
République du Gabon (50 F bleu)
- créées par Louis Mühlemann
- timbre dessiné par C. Halley
- imprimeur : pas d'information
• Les armoiries figurant sur les quatre timbres suivants, monochromes, sont conformes aux conventions de l'héraldique, qui substitue aux couleurs un système normalisé de hachures ou de points (malheureusement peu lisibles en raison de la taille du timbre, et de la qualité de la reproduction)
La description complète des armoiries a été réalisée dans le premier volet, voir →
ICIannée 1977
N° 381 YT
N° 637 MI
Armoiries de la
République du Gabon (60 F orange)
- créées par Louis Mühlemann
- timbre dessiné par C. Halley
- imprimeur : pas d'information
année 1977
N° 379 YT
N° 638 MI
Armoiries de la
République du Gabon (80 F rouge)
- créées par Louis Mühlemann
- timbre dessiné par C. Halley
- imprimeur : pas d'information
année 1977
Aérogramme AE1 (YT)
←
détail du timbre postal préimprimé sur le support servant d'enveloppe.Armoiries de la
République du Gabon- créées par Louis Mühlemann
- timbre dessiné par Combet
- imprimé par Edila
.
Villes du Gabon - série VIII
année 1978
N° 403 YT
N° 676 MI
Armoiries d'Oyem (district)
(chef-lieu de la province de Woleu-Ntem)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"D'argent à trois tourteaux de gueules posés en pal, accostés de deux pals ondés de sinople; au chef de gueules chargé de trois cabosses de cacaoyer d'or en bande".
• Les pals ondés évoquent le fleuve Woleu et la rivière Nyé.
• Les couleurs gueules et argent symbolisent la culture du caféier (fruit et fleur du café), le sinople représente la forêt.
• Si les cabosses sont les fruits du cacaoyer, les tourteaux évoquent aussi les baies rouges du caféier.
![]()
année 1978
N° 404 YT
N° 677 MI
Armoiries d'Okondja
(ville et district de la province du Haut-Ogooué)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"De gueules à deux sagaies d'argent posées en sautoir accompagnées de quatre têtes de léopard d'or, lampassées d'azur".
• Les couleurs gueules et argent symbolisent la culture du caféier.
• Les lances et les léopards symbolisent la défense et la vigilance .
année 1978
N° 405 YT
N° 678 MI
Armoiries de Mimongo
(ville et district de la province de Ngounié)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"D'azur au bongo d'or, zébré de sable, au chef émanché d'or ".
• Le champ d'azur et l'émanché évoquent le paysage lointain bleuté des collines de Mimongo.
• Le chef d'or symbolise l'exploitation de ce métal.
• Le bongo (Tragelaphus eurycerus) est une antilope discrète des forêts du Gabon.
![origine image : http://www.factzoo.com/mammals/bongo-beautiful-striped-antelope.html]() |
| le bongo (Tragelaphus eurycerus) magnifique antilope des forêts du Gabon, dont l'habitat est très menacé |
Blasons série I / Villes du Gabon - série IX
année 1979
N° 412 YT
N° 691 MI
Armoiries de la province d'
Ogooué-Maritime- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"De sable à trois flammes d'or, 2 et 1, à la champagne fascée-ondée d'argent et d'azur de quatre pièces".
Timbre: couronne d'or antique à pointes de lance des provinces gabonaises.
• Les couleurs or et sable (noir), les flammes évoquent l'or noir, le pétrole, les hydrocarbures exploités en majorité en
offshore, sur le littoral de la province. Les ondes symbolisent naturellement l'océan.
année 1979
N° 413 YT
N° 692 MI
Armoiries de Lastoursville
(ville et district de la province d' Ogooué-Lolo)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"D'azur au masque Bakota d'or orné de gueules et du champ, accosté de deux défenses d'éléphant d'argent, au chef du même chargé de deux pagaies de gueules posées en sautoir".
•Le masque Bakota et les pagaies des Adoumaévoquent la vie et les traditions des principaux groupes ethniques du district.
• Les défenses rappellent aussi malheureusement la tradition de production de l'ivoire et donc indirectement la contrebande et le massacre intolérable des éléphants.
• Le champ d'azur symbolise le fleuve Ogooué.
![]()
année 1979
N° 414 YT
N° 693 MI
Armoiries de
Mbigou (
ville et district de la province de Ngounié)
- auteur/dessinateur : pas d'information
- imprimé par Delrieu
"De gueules à une étoile à huit rais d'or, quatre rais en croix lancéolés et quatre rais en sautoir flamboyants, un écusson d'argent sur le tout, chargé d'une tête humaine de sable".
• La couleur rouge du champ rappelle le fruit du caféier.
• Les rayons évoquent les mines de diamants.
• L'écusson et la tête évoquent les réalisations artistiques, notamment les sculptures faites à partir de
la pierre de Mbigou, de la stéatite grise à reflets verts ou grenat, réputée depuis des décennies par les artistes sculpteurs et artisans locaux.
Pour l'anecdote, on trouve aussi des armoiries dans les marges de ce bloc-feuillet commémoratif :
année 1979 - Bloc-feuillet BF 33 YT - SB 37 MI
Exposition Philexafrique 2 à Libreville en 1979 - 5 timbres : fleurs du Gabon et logo
ornements extérieurs : petites armoiries de la
République du Gabon- armoiries créées par Louis Mühlemann
- imprimé en lithogravure
○------------------------------------------○
Pour finir, voici quelques enveloppes philatéliques utilisant ces beaux timbres et complétant la collection :
• source informations et textes :
www. philagabon.com qui est LA référence mondiale en ce qui concerne la philatélie du Gabon :
Je remercie encore M. Rousseau et son webmaster, sans lesquels ce sujet n'aurait pas pu voir le jour, avec autant de détails introuvables par ailleurs. Je vous conseille vivement de visiter son site qui est une vraie mine d'or pour ce qui touche au Gabon, même si vous n'êtes pas collectionneur (cliquer sur le lien ou le bandeau ci-dessus).
• images timbres, lettres :
www. timbres-afrique-francophone.comcolnect. com/frwww. delcampe.netÀ bientôt pour le troisième et dernier volet de ce thème ... Herald Dick ![]() .
.![]() .
.






























































































































































































.png)










































































































 .
.